Une communauté restreinte d’acteurs occupe le marché de la protection des œuvres d’art en France. Lequel est segmenté en trois volets : surveillance volumétrique (intérieur), périphérique (extérieur) et périmétrique (l’enveloppe des bâtiments). Objectif : repousser le malfaiteur qui ne pourra emporter, au final, qu’un tableau piégé, puisque tracé et authentifié.
Le monde de l’art est un marché juteux… devant lequel il faut montrer une patte complètement blanche. « Ici sommeillent des œuvres dont la valeur dépasse l’entendement », confie un galeriste situé dans un quartier de Paris bien connu des amateurs d’art. « Chaque jour, de richissimes collectionneurs se pressent entre ces murs… mais pas forcément aux heures d’ouverture. » En effet, il arrive que des voleurs se glissent dans la foule des clients, prennent leurs renseignements avant de revenir à la nuit tombée. En mai 2010, au cours d’une opération coup-de-poing, plusieurs hommes ont pu dérober cinq tableaux au musée d’Art moderne de Paris. Valeur totale du casse : près de 100 millions d’euros. Des cambrioleurs de haut vol… « Des professionnels qui remplissaient sans doute un contrat pour le compte d’un milliardaire prêt à payer un tableau jusqu’à quarante fois sa valeur réelle », analyse un second galeriste. « Cela simplement afin de pouvoir l’exposer chez lui ou l’enfermer dans un coffre-fort. » Causant du même coup une atteinte inestimable au bien public…
Sécuriser l’accès
Pour affronter cette menace, les responsables sécurité ont un plan de bataille. Premièrement : ils mettent en place une surveillance « périphérique » afin de garder à l’œil l’extérieur des bâtiments, via un système de vidéosurveillance par exemple. Deuxièmement : ils installent des capteurs « périmétriques » pour contrôler l’enveloppe des bâtiments, c’est-à-dire les murs, les portes, les fenêtres, etc. A la brisure d’une vitre ou l’apparition d’une vibration non attendue, le capteur déduit que l’œuvre est attaquée et donne l’alerte. Troisièmement : ils fixent des détecteurs sur l’œuvre elle-même ou sur ses rebords. Il s’agit de systèmes de protection rapprochée des œuvres (Pro). « Le système génère une cage invisible, en trois dimensions, qui englobe l’œuvre », détaille Frédéric Pithoud, fabricant de ce système baptisé Monalitag. « Basés sur une technologie RFID, les capteurs analysent ensuite les variations de mouvement effectuées par l’œuvre. Si un objet l’approche ou si l’œuvre change de position, les capteurs communiquent en RFID avec une base distante, qui émet un son d’alerte strident. » Objectif : repérer l’importun et le déstabiliser afin de le couper dans son élan.

Protection physique
D’autres éléments viennent en renfort. Par exemple des systèmes d’accrochage muraux sécurisés, qui nécessitent une authentification pour décrocher le tableau. « Ces “clips” de sécurité se retrouvent aujourd’hui dans la majorité des musées au Royaume-Uni », souligne Madleen Clament, responsable commerciale Europe chez Absolute Museum & Gallery Products, un fabricant anglais qui équipe également le musée du Louvre, le centre Georges Pompidou et le musée d’Art moderne de New-York. « Pour être ouverts, ils nécessitent une clé de sécurité physique. » En pratique, chaque clé est numérotée et les utilisateurs sont enregistrés dans une base de données. Autre élément à prévoir : des vitrines hautement résistantes. « L’idée est que le cambrioleur ne comprenne pas comment les briser ou les désassembler. Ce qu’il faut, c’est lui faire perdre du temps. Pour garantir ce tour de force, il faut des vitres en verre feuilleté (comme celui des pare-brises de voiture NDLR), maintenu par une structure en acier. En outre, les jointures doivent rester invisibles », explique Albane Dolez, créatrice des vitres Veralbane adoptées par près de 500 musées dont le département des antiquités égyptienne du Louvre.

Télésurveillance
En outre, les galeries et musées disposent, pour la plupart, d’un contrat de télésurveillance. Certains établissements sont directement reliés au commissariat le plus proche. Les autres passent par les services d’une société privée. Citons Securitas, Sofratel, Delta Security… Leur rôle : installer et centraliser l’ensemble des équipements de sécurité d’un site, 24 heures sur 24. « Nous sommes des ensembliers de la sécurité », explique le directeur d’une société de télésurveillance qui souhaite garder l’anonymat. « Rien n’est laissé au hasard. Nous connectons le système, enterrons les câbles réseaux blindés dans le sol et entretenons les batteries de secours. » Au final, le Graal des sociétés de télésurveillance, c’est l’obtention de la certification Apsad P3, qui consacre leur plus haut niveau de développement possible dans le référentiel technique du Centre national de prévention et de protection (CNPP). Spécificité de niche : un rapport constant avec des clients prestigieux qui ne souffrent aucune erreur. « Le savoir-faire est une clé de ce métier », reprend le directeur. « L’autre secret, c’est de choisir une stratégie d’achat gagnante et de s’y tenir. Mieux vaut cibler dès le départ un matériel haut de gamme, plutôt que de payer ensuite le prix fort en termes de maintenance. » Ou en perdant un gros client…
Protection électronique
Autre tendance : l’ère du tout automatique se répand sur la sécurité des œuvres d’art. Sous les projecteurs, les systèmes de vidéosurveillance apparaissent comme de véritables couteaux suisses pour les galeries et musées. En pratique, ces caméras intelligentes sont désormais capables d’alerter le responsable sécurité si une anomalie apparaît dans le comportement d’un usager. Par exemple, s’il s’approche trop près d’une œuvre… Principe : la caméra trace un trait à l’intérieur de sa propre image. Ensuite, elle analyse le franchissement de ce marquage virtuel par les usagers. « La finesse du trait autorise des programmations subtiles. L’opérateur peut notamment autoriser le franchissement partiel du trait », poursuit Gregory Pittet, responsable marketing Europe du sud et de l’est chez Sony.
« Lorsqu’une anomalie dure plus de quarante secondes, la caméra se met à sonner. » Concrètement, les caméras munies de cette fonction de surveillance sont capables de lancer des actions du type démarrer une sirène, allumer ou éteindre des lumières à distance, afficher une alerte directement sur le téléphone mobile du responsable de la sécurité du musée ou de la galerie pour le prévenir d’une anomalie.

Entre esthétisme et fonctionnalités
La pose d’un système de sécurité n’est pas chose aisée dès lors qu’il est destiné à équiper un monument historique, tel qu’un château ancien. « Nous avons une gamme de caméras si petites qu’elles se fondent aisément dans le déco », souligne Grégory Pittet, responsable marketing Europe du Sud et de l’Est, chez Sony. Concrètement il s’agit de la série X du constructeur, de minidômes encastrables de la taille d’un téléphone portable (4 cm x 9 cm) pour un poids d’à peine 100 grammes. « Mais il nous a fallu réduire toutes les options au minimum », continue le responsable marketing. En pratique : pas de View DR, la technologie de Sony qui reprend la technique dite HDR (high dynamic range) bien connue des amateurs de photographie. Principe : la caméra prend quatre fois plus d’images que d’habitude au cours de l’enregistrement. Avec, à chaque fois, des valeurs de luminosité différentes. Ensuite, la caméra mélange les clichés, donnant au résultat une lumière idéale. Parfait pour voir, même en plein contre-jour, tous les détails d’une scène de vol. « Mais ces minicaméras n’intègrent ni l’audio, ni “l’Anti-Tampering’”, qui consiste pour la caméra à analyser en permanence la couleur de chaque pixel qu’elle enregistre », reprend l’intervenant. « De cette manière, celle-ci est capable de se prémunir seule contre le “bombage” ou le “masquage” de sa lentille. Auquel cas, elle déclenche une alerte. » Sans oublier que les caméras haut de gamme sont construites pour fonctionner pendant dix ans sans interruption. « Tout ça n’est pas disponible sur les petits modèles de la série X ,regrette Gregory Pittet. Il y a véritablement un choix à faire entre esthétisme et fonctionnalités. »
Automatisation
« Les caméras actuelles s’adaptent et offrent un premier niveau de réponse automatique à tous les établissements qui n’ont pas les moyens de se doter d’un contrat de télésurveillance », souligne le responsable marketing de Sony.
« Les possibilités d’automatisation sont infinies. » Par exemple, les caméras peuvent être couplées avec un générateur de fumée. « L’information part de la caméra pour rejoindre la carte électronique du générateur », explique Christophe Dessain, responsable des exportations chez Protect France, fabriquant de matériel. « L’appareil effectue une vérification supplémentaire, via son propre détecteur, qui mesure à la fois la température et le mouvement dans la pièce. » Si l’appareil retrouve la même anomalie que la caméra, un brouillard sec envahit la pièce et opacifie l’air. Sans toutefois occasionner de dépôts, de dégradations ou de résidus. « On ne peut pas voler ce qu’on ne voit pas… Or, là, le malfaiteur ne voit plus rien à plus de 30 cm de son visage », souligne Christophe Dessain. « A l’installation, il faut faire en sorte de repousser l’intrus vers l’extérieur. Concrètement, il faut que la porte reste visible malgré la fumée. Du coup, le malfaiteur n’a d’autre choix que de s’enfuir de lui-même. » En une dose, le nuage peut opacifier jusqu’à 400 m2. En outre, l’appareil peut se déclencher de huit à 30 fois selon le volume à remplir. Reste à régler sa sensibilité, pour qu’il ne réagisse pas au passage d’un chat ou d’un insecte par exemple, mais qu’il reste opérationnel au passage d’un humain.

Stockage et conditionnement
Force est de constater que de nombreuses galeries restent encore mal protégées. « Du coup, elles n’exposent pas leurs œuvres de grande valeur », confie un galeriste. « En réalité, leurs véritables trésors sont stockés ailleurs, chez un transitaire. » A savoir : des entreprises qui louent des espaces de stockage aux galeries et musées. De grands transporteurs du secteur ont également développé ce type offre. Parmi les plus connus, citons André Chenu. Pour des bourses plus modestes, les organismes, du type Une Pièce en plus, peuvent également effectuer le stockage des œuvres. Le tout est de disposer de caisse en bois, taillées sur mesure aux dimensions de l’œuvre et emballées dans les règles de l’art pour éviter toute détérioration. Problème : lors d’un transport, la logistique des caisses devient lourde à gérer. « A chaque fois, il font fabriquer des caisses sur mesure et en jettent l’essentiel après coup parce que c’est difficile à stocker », remarque Hervé Poux, inventeur de Nid’art, un outil innovant de transport de toiles de peinture, même de différentes tailles, même fraîches. Son secret : la forme concave de ses « valises ». « Du coup, la toile ne touche que dans les coins, jamais sur sa surface », explique Hervé Poux. « A l’intérieur, on peut mettre des toiles de différentes dimensions pendant le même voyage. Au final le nombre de caisses nécessaires est réduit. »
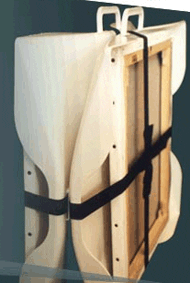
Déplacer
Les mieux lotis, concernant le transport des œuvres, sont sans doute les galeristes qui expédient des photographies d’art. « Nous utilisons de simples boîtes en carton, peu chères à l’achat, qui ont l’avantage d’être dénuées d’acides, un composant dangereux pour les tirages. En outre, nous enrobons les photographies avec du papier spécial, qui ne dégage aucune particule », détaille l’un d’entre eux. Reste toutefois un danger qui guette les expéditeurs de biens culturels : les attaques pendant le transit. « Notre règle d’or, c’est la discrétion », souligne Thomas Ledieu, directeur de Art Solution, spécialiste du transport d’œuvres d’art. « Nous n’utilisons que des voitures banalisées. En outre, les hommes qui composent l’escorte sont triés sur le volet. Le plus souvent, il s’agit d’anciens militaires ou policiers reconvertis dans le privé. » Leurs principales qualités : un esprit rigoureux, une grande disponibilité pour faire face aux aléas du voyage… et de la force physique à revendre. Dans de rares cas, la gendarmerie peut prêter main-forte à l’équipe. Toutefois, les grands musées ne laissent jamais voyager une œuvre sans installer, en sus, un système de localisation visant à garder une trace du déplacement des œuvres. En pratique, il peut s’agir soit d’une puce GPS, soit d’un simple téléphone mobile GSM. « Nous glissons un portable dans certaines caisses et pouvons les suivre en direct depuis nos ordinateurs grâce à un logiciel spécifique », explique Thomas Ledieu.
Ce Picasso m’appartient-il vraiment ?
Pour retrouver son œuvre, il reste toujours possible d’enquêter soi-même. Encore faut-il être en mesure de prouver qu’il s’agit de la bonne ! « Nous effectuons un trou de quelques millimètres de profondeur dans l’œuvre, juste assez pour y rentrer un cône RFID », note Henri Brénot, l’éditeur de Sol3, une solution visant à authentifier de manière formelle les œuvres d’art des galeries, musées et particuliers. « Puis nous scellons hermétiquement le trou. L’artiste peut même repeindre par-dessus pour garantir l’invisibilité du système. » Reste à s’équiper d’un lecteur permettant de lire le contenu de la puce et de comparer le numéro obtenu le cas échéant avec celui d’origine. Autre solution : les codes à bulles, dont le brevet est détenu par Prooftag, une entreprise innovante qui a reçu la récompense de « Meilleure innovation technologique d’une PME ou d’une Start-up », dans le cadre des Trophées 2011 de la sécurité privée, au Casino de Paris. Le produit se présente sous la forme de trois « scellés » dont l’un se colle sur l’œuvre. « Sans rien abîmer car nous utilisons une colle à Ph neutre qui n’altère pas les supports », précise Laetitia Daucé, directrice marketing d’ARTtrust, filiale de Prooftag. « Au bout d’une demi-heure la colle est sèche et le scellé ne peut plus être retiré sans s’arracher. » Chaque scellé contient un petit carré en polymère (plastique, NDLR), lequel est rempli de bulles d’airs restées prisonnières. « Il n’y en a pas deux pareil. Ce phénomène naturel garantit l’authenticité absolue de l’œuvre », souligne Laetitia Daucé.

Retrouver
Malgré toutes ces précautions, une œuvre d’art peut disparaître. Dès lors, le jeu normal des assurances se met en branle. A savoir, selon le lieu de la disparition, celle de l’expéditeur qui a pris en charge le trajet de l’entrepôt de départ jusqu’à l’emplacement de destination. Ou celle du destinataire, qui a pris la suite à partir de ce moment-là. En parallèle, le galeriste peut contacter l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC). Créée en 1995, modernisée dix ans plus tard, la base Treima, éditée par l’Office, contient à l’heure actuelle près de 85 000 œuvres volées en France. « Nous récupérons toutes les photographies des œuvres dérobées, ainsi que les plaintes qui y sont associées. Chaque image est ensuite rattachée à un dossier qui explicite les conditions du vol », explique le commandant Jean-Luc Boyer, de l’OCBC. « Une fois rentrée dans la base, ces dossiers sont accessibles à tous nos services. Nous n’ouvrirons finalement pas la base au public comme le fait aujourd’hui Interpol. » En outre, le système évolue. Au traditionnel “Thesaurus”, qui répertorie par mot clé l’ensemble des œuvres, se substitue peu à peu un véritable logiciel de reconnaissance d’image. Mais un problème demeure. « Cela ne fonctionne bien qu’avec des œuvres d’art en 2 D. Autrement dit, des toiles de peinture », reconnaît le commandant. « Pour l’instant, ce système est beaucoup moins efficace pour retrouver des œuvres en 3 D, de type sculpture. » Reste à mener l’enquête soi-même (lire l’encadré ci-dessus).
© Guillaume Pierre / Agence TCA-innov24

Commentez